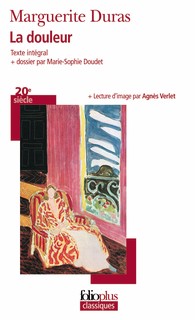Dans ce roman, tout part du ciel, tout est affaire du temps qu’il fait, qu’il a fait ou qu’il fera. Comme si chaque événement était lié aux affres de la météo. Et c’est à travers de multiples descriptions de ce ciel, de cette atmosphère étrange que nous faisons la rencontre d’un drôle de trio le temps d’un instant… Pierre, Maria et Claire. Pierre et Maria sont mariés, ils ont une fille, Judith, et Claire semble être une amie de l’épouse. Ils sont quatre (l’enfant étant à mon avis un personnage secondaire). En vacances. En route pour Madrid.
Mais l’histoire commence par un meurtre passionnel qui a lieu dans une ville perdue de Castille, là où les vacanciers ont dû s’arrêter à cause de l’orage : Rodrigo Paestra vient de tuer sa femme et son amant, avant de s’enfuir sur les toits. Point de départ (prétexte ?) surprenant pour raconter ce huis-clos infernal, étouffant entre ces trois personnages. Etouffant parce qu’il fait lourd -l’orage gronde- et la chaleur moite envahit les esprits et les cœurs. Etouffant parce que Le narrateur, pourtant externe à cette histoire, nous plonge dans les méandres des pensées de Maria. Etouffant par le choix-même de l’auteure de ces descriptions récurrentes, comme une métaphore filée de l’âme amoureuse de Maria. Les phrases sont courtes, factuelles. Pourtant, les émotions les plus intimes de cette femme abimée par la vie nous explosent à la figure et la tension ne cesse de monter au fil des pages parce qu’elle sait tout Maria, elle sent tout, elle devine…
Il s’agit d’une nuit. Pendant laquelle tout aurait pu changer. C’est la nuit avec l’alcool, avec les rencontres surprenantes, avec les réflexions qui prennent toujours une autre ampleur dans l’obscurité du soir. Tout aurait pu changer dans la vie de Maria, à dix heures et demie du soir (et les quelques heures de la nuit qui suivirent).
« Il la regarde, la regarde, la regarde. D’un regard nul, d’un désintérêt jusque-là inimaginable. De quoi s’aperçoit-il encore en regardant Maria ? De quel étonnement revient-il encore en la découvrant ? S’aperçoit-il seulement à l’instant que rien ne peut plus lui venir encore de Maria, ni de Maria, ni de personne ? Qu’avec cette aurore se démasque encore une certitude nouvelle que la nuit gardait cachée ? » (pp.89-90)
Roman singulier que l’on continue de lire même quand certains passages « énervent », « agacent » (les trop nombreuses descriptions pour ma part) … Quelque chose appelle à la lecture, cette tension grandissante peut-être…
(Dix heures et demie du soir en été. Marguerite Duras. Editions Gallimard : 1960 ; collection Folio : 1986)